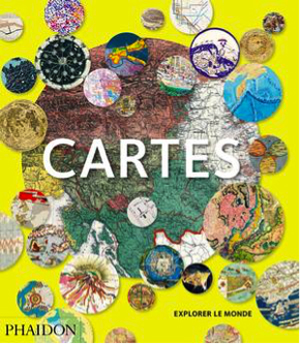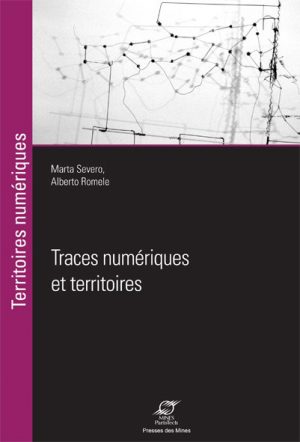 Le développement des outils numériques et de leur usage quotidien par les habitants, les élus, les chercheurs amènent à étudier les territoires à partir de nouveaux attributs. Dans l’ouvrage dirigé par Marta Severo et Alberto Romele, l’étude des territoires a pour terrain de recherche les médias numériques. Les internautes y laissent des traces que le chercheur peut extraire, traiter, analyser et visualiser. Cet ouvrage offre une diversité des approches disciplinaires sur le sujet puisque les 15 auteurs sont issus des sciences et disciplines que sont la géographie, la sociologie, la philosophie, l’urbanisme, l’information et la communication ou sa variante numérique « les nouveaux médias ». Au fil des onze chapitres, des approches empiriques et théoriques diverses sont présentées sur le traitement des traces numériques qui ouvre la voie à de nouvelles études des territoires. Mais la question de la qualification de ce terme territoire reste ouverte, les auteurs étudient-ils un territoire « physique » et/ou « numérique » ?
Le développement des outils numériques et de leur usage quotidien par les habitants, les élus, les chercheurs amènent à étudier les territoires à partir de nouveaux attributs. Dans l’ouvrage dirigé par Marta Severo et Alberto Romele, l’étude des territoires a pour terrain de recherche les médias numériques. Les internautes y laissent des traces que le chercheur peut extraire, traiter, analyser et visualiser. Cet ouvrage offre une diversité des approches disciplinaires sur le sujet puisque les 15 auteurs sont issus des sciences et disciplines que sont la géographie, la sociologie, la philosophie, l’urbanisme, l’information et la communication ou sa variante numérique « les nouveaux médias ». Au fil des onze chapitres, des approches empiriques et théoriques diverses sont présentées sur le traitement des traces numériques qui ouvre la voie à de nouvelles études des territoires. Mais la question de la qualification de ce terme territoire reste ouverte, les auteurs étudient-ils un territoire « physique » et/ou « numérique » ?
Le premier chapitre, comme les trois suivants, composent une première partie dédiée à la restitution de travaux dans une approche empirique. Richard Rogers introduit dans le premier chapitre les big data dans la recherche sociale et politique. L’auteur souligne le risque d’observer plus le fonctionnement des réseaux sociaux numériques qu’une quelconque tendance sociétale. De plus, l’automatisation de la collecte néglige dans de trop nombreuses études l’éthique sur l’utilisation de ces données à caractère personnel tandis que le traitement par agrégation ou par localisation des données pour présenter des résultats peuvent conduire à une « cécité computationnelle », celle de leurs conditions de production au nom de la perspicacité. Les études numériques mettent alors en place de nouvelles métriques pour analyser le territoire qui sont basées sur l’activité des internautes dans un environnement propre qui est celui du web. Les trois tendances méthodologiques sont : l’analytique culturelle (métrique des images, des selfies sous forme de grille) ; la culturnomique (métrique linguistique visualisé sous forme de graphiques) et la cybermétrie (métrique des citations entre sites web visualisées sous forme de graphes).
Mais qui du chercheur ou de la plateforme, telle que Facebook, influence le choix de la méthode, s’interrogent Noortje Marres et Carolin Gerlitz dans le deuxième chapitre. Face à ce « troublant mystère méthodologique », les auteurs développent la notion de méthodes d’interfaces. Ces méthodes émergentes demeurent proches des intérêts et des démarches scientifiques et reposent dans le même temps, et indubitablement, sur les outils créés pour le grand public par les plateformes web. Ces instruments variés, des chercheurs et des industriels, entrent en résonance.
Des méthodes, le troisième chapitre glisse vers le statut de ces données et la perplexité du chercheur face à ces données qui débordent des catégories déjà existantes et mobilisées dans le cadre des analyses des territoires. Nous dirons donc que les catégories se délitent dans cette analyse des territoires et du web. Après une définition des termes ou expressions data, big data, open data, c’est le terme soft data qui est retenu par Marta Severo et Alberto Romele afin de les distinguer des hard data, ces données institutionnelles qui ne procurent pas de satisfaction aux décideurs publics. Pour ces auteurs, ces traces que sont les soft data permettent dans une perspective immanente de capter l’instantanéité de la vie des territoires. Les chercheurs souhaitent ici se trouver au plus près du temps du territoire, celui qui est vécu par les individus que les traces reflètent. Il est à noter qu’il n’est pas envisagé dans le texte de croiser ces données institutionnelles avec des données issues d’acteurs économiques du web. Dans le quatrième chapitre, Jos de Mul décrit l’identité de ces individus devenue une base de données. L’identité mise en données s’éloigne alors de la question du récit et de la narrativité.
Le cinquième chapitre ouvre une deuxième partie constituée de quatre chapitres où des approches théoriques sont développées. Dominique Boullier décrit l’écume numérique des territoires, ou plus précisément ce que produisent les traces numériques à partir de huit propriétés des territoires et de trois agencements qui définissent chacun une architecture technique et de données selon une époque donnée. Le fil conducteur est la transposition de chacun de ces agencements. L’agencement topographique formé autour des notions de pouvoir et de frontières est transposé dans un agencement topologique reposant sur la distribution et l’accès qui est lui-même transposé dans un « territoire » à agencement chronologique. Ces trois agencements sont résumés page 131 dans un tableau. Ce tableau compare par exemple, la centralité issue du premier agencement avec la distribution du deuxième agencement et les rumeurs, les issues qui se déploient sur le mode de la vibration le troisième agencement dit chronologique. L’espace laisse place ici à l’analyse des temps des territoires de plus en plus volatiles, éphémères et l’auteur propose alors une analyse des écumes urbaines et territoriales.
Le sixième chapitre questionne les spatialités algorithmiques ou les dimensions « éminemment » spatiales des traces numériques. Boris Beaude développe deux concepts : l’hypercentralité et la synchronisation. Car, pour l’auteur, les pratiques des individus se réalisent dans un nombre limité d’espaces et dans un temps qui se réagencent dans ce qui pourrait être nommé une « topochronie ». Le panorama des questions soulevées est vaste : la visualisation des données et la connaissance d’un environnement, l’exploration des traces et la révélation de leur potentiel, la recherche des traces par localisation, les perspectives des traces pour un territoire événement. L’ensemble de ces représentations de l’espace comme la localisation des images de plateformes (Twitter, Panoramio, Facebook ou Tripadvisor) réduit alors le monde à l’individu, à la surveillance de ses traces et moins au sens produit par ses traces.
C’est cette trace comme donnée qui est au cœur du septième chapitre, centré autour du concept d’hyperville développé en 10 tableaux par Franck Cormerais. L’hyperville se distingue des concepts de smartcity, de ville intelligente et de la gouvernance algorithmique. Il a pour but de définir un système contributif local, reposant sur des pratiques numériques de contributeurs qui participent aux communs, à la valorisation du territoire. Ce système contributif local repose sur un système local de données qui participent elles-mêmes à un « espace public digital ». Ces données sont produites par des fans. Reprenant la pharmacologie de Stiegler, l’auteur interroge son modèle de l’hyperville. Il conclut que les données et les pratiques numériques des contributeurs développent la base informationnelle individualisée de l’hyperville qui alimente ainsi le système contributif local.
Le huitième chapitre prolonge la réflexion théorique ouverte par les trois chapitres précédents, en interrogeant le « désir de data ». Les deux auteurs, Maryse Carmes et Jean-Max Noyer, sont les directeurs de la collection « territoires numériques » aux Presses des Mines, dans laquelle est édité cet ouvrage. Pour ces auteurs, les données, pour qu’elles sortent de la pauvreté sémiotique des statistiques, des algorithmes et des graphes, doivent rentrer dans le désirable par le biais de la narration mêlant open-data et marketing. Ces données sont donc localisées, territorialisées, re-territorialisées peut-être pour appuyer autant une institutionnalisation qu’un marketing territorial. S’éloignant du territoire ou des traces spatiales, les auteurs critiquent l’utilisation des données personnelles, les ontologies de client mobilisées, les cartographies valuées par ce « tiers de confiance » qu’est le marketing ainsi que la performativité de son discours. La communauté au sens politique perd de sa substance pour aller vers des horizons post ou trans-humanistes définis à travers un ensemble de textes que les auteurs commentent au cours de la dernière partie du chapitre.
Le neuvième chapitre, quant à lui, entraîne le lecteur vers des exemples appuyés par des terrains d’analyse qui vont conduire toute cette dernière partie centrée sur les pratiques professionnelles. Mathieu Noucher revient sur le savoir cartographique et les nouveaux acteurs de l’information géographique comme OpenStreetMap et Google Maps. Si, précédemment, l’intentionnalité géographique pouvait se résumer aisément en une carte qui était contrôlée de la collecte de données à la localisation des données sur un fond de carte par un État pour asseoir son pouvoir, cette rhétorique de la carte est dorénavant critiquée. Les nouveaux acteurs offrent une nouvelle fabrique cartographique entre pratiques des amateurs dans un projet non lucratif et captation de traces dans un but lucratif. Cette nouvelle fabrique discute à la fois les référentiels géographiques, les capacités d’accès aux données et la personnalisation des cartes par les algorithmes. Que les traces soient laissées volontairement ou involontairement, personnalisées ou agrégées, c’est le « faire trace » (Jeanneret, 2011) qui permet d’écrire et de lire le territoire. Le processus de construction de la carte est ici judicieusement interrogé en observant cette construction cartographique entre le savoir cartographique et une sémiotique des cartes.
S’éloignant des cartes comme savoir géographique, Marta Severo et Laurent Beauguitte s’intéressent aux flux RSS. Dans le dixième chapitre, les auteurs proposent un regard critique sur les potentialités et les problèmes méthodologiques des traces numériques à travers leur définition de l’information géographique. L’analyse des dimensions spatiales dans l’actualité internationale s’appuie le plus généralement sur des bases de données privées, comme Dow Jones Factiva. Les auteurs choisissent de les étudier à partir de 1304 flux RSS de la rubrique internationale du journal The New York Times. Les auteurs considèrent que le « web 2.0 » permet d’accéder à une information gratuite et en temps réel. Cette information s’avère tout de même coûteuse du fait des problèmes techniques et méthodologiques à résoudre pour automatiser leur qualification. Leur analyse conclut à une hiérarchie des lieux, une hypothèse qui reste valide depuis 50 ans (p. 233), et à la place prédominante des individus, célèbres et médiatiques, dans cette actualité internationale à dimension géographique.
Nicolas Douay et Maryvonne Prévost concluent cet ouvrage en analysant le rôle de la plateforme participative Carticipe dans les politiques urbaines. La carte, même participative, demeure un instrument de pouvoir selon les auteurs. Mais en s’intéressant plus précisément aux formes d’engagement, de participation et de négociation par la rencontre entre des savoirs d’experts et des savoirs d’habitants, ils décortiquent ces différentes manières de « faire-carte » entre un territoire vécu et administré. Le récit par entretien plus que l’analyse des traces présente le rôle prescriptif de ce dispositif sociotechnique au niveau de la participation. Comme le soulignent de nombreux travaux de recherche menés sur la thématique de la démocratie dite participative, cette participation est majoritairement portée par des contributeurs ayant des activités militantes ou associatives avec pour thème le plus commenté celui des transports au niveau de l’open data. Les traces numériques du territoire ne sont pas analysées dans ce chapitre pour elles-mêmes mais sont mises en perspective avec les récits des créateurs de la plateforme et des contributeurs.
Cet ouvrage présente un panorama des questionnements théoriques et méthodologiques autour de la notion de « territoires numériques » et de « traces numériques ». La collecte, le traitement des données et la nécessité de repenser cette notion de territoire numérique sont balisés autant du point de vue des chercheurs que des praticiens. L’ouvrage est à conseiller pour tout enseignant et étudiant souhaitant découvrir une approche transdisciplinaire sur les territoires numériques. L’analyse des traces numériques et la définition de nouvelles politiques urbaines ou territoriales doivent autant reposer sur des méthodes quantitatives que qualitatives. Les questions éthiques que pose l’exploitation de ces traces ou bases de données, de plus en plus liées à des individus, ne sont que peu abordées. Pourtant, la nécessité de les prendre en compte est soulignée par Richard Rodgers, sous forme d’une mise en garde, au début de l’ouvrage.
Référence de l’ouvrage :
Severo M., Romele A. (2015). Traces numériques et territoires. Paris : Presses des mines, 268 p. ISBN 78-2-35671-206-6. En ligne